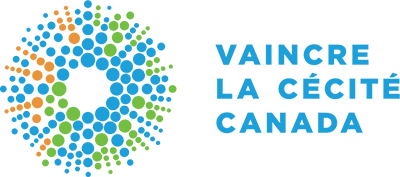Glaucome
Aller à : Causes | Types et symptômes | Facteurs de risque | Diagnostic | Traitements | Recherche| Ressources | Références
SURVOL
Le glaucome est la principale cause de perte de vision irréversible au Canada. Il désigne un groupe d’affections qui entraînent une atteinte visuelle permanente en endommageant le nerf optique (le nerf qui transmet les signaux lumineux de la rétine jusqu’au cerveau) sous l’effet d’une pression trop élevée dans l’œil. Il n’existe aucun remède pour soigner la maladie, mais le dépistage et le traitement précoces peuvent contribuer à prévenir l’atteinte du nerf optique et donc la perte de vision.
CAUSES
Nos yeux contiennent un liquide appelé « humeur aqueuse », qui occupe la chambre antérieure de l’œil. Ce liquide contribue à maintenir la forme du globe oculaire tout en lui apportant les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Dans un œil en santé, l’humeur aqueuse se renouvelle sans cesse : la quantité sécrétée est contrebalancée par l’excrétion d’une quantité équivalente, un processus qui permet de garder une pression stable dans l’œil.
En présence d’un mauvais drainage du liquide, celui-ci peut s’accumuler et augmenter la pression intraoculaire (PIO). Si elle est trop élevée, cette pression risque d’endommager les fibres du nerf optique et de provoquer une perte de vision. Le nerf optique est constitué de fines fibres nerveuses qui acheminent les signaux visuels de la rétine au cerveau. La détérioration de ces fibres altère la transmission de l’information lumineuse et entraîne l’apparition de points aveugles (scotomes) dans le champ visuel.
TYPES DE GLAUCOME ET SYMPTÔMES ASSOCIÉS
Il existe différents types de glaucome, chacun affectant l’œil de manière légèrement différente.
Glaucome à angle ouvert
Le glaucome à angle ouvert, la forme la plus répandue, touche environ 90 % des personnes atteintes de glaucome [1]. Il se caractérise par un mauvais écoulement de l’humeur aqueuse à l’origine d’une hyperpression intraoculaire. En augmentant, la pression endommage le nerf optique et entraîne l’apparition de taches aveugles dans le champ de vision périphérique (c.-à-d. sur les côtés). Comme ces taches aveugles se trouvent en périphérie du champ de vision et qu’elles sont indolores, la maladie demeure silencieuse dans les premiers stades de son évolution. Chez certaines personnes, elle n’est diagnostiquée qu’après une perte de vision importante. C’est pourquoi il est essentiel de passer régulièrement un examen de la vue. Votre ophtalmologue pourra ainsi réaliser des tests de dépistage pour détecter le glaucome à un stade précoce et prévenir toute atteinte oculaire.
Glaucome à angle fermé
Moins courant, le glaucome à angle fermé est une urgence médicale. Aussi appelé « glaucome aigu », « glaucome à angle étroit » ou « glaucome par fermeture de l’angle », ce type de glaucome survient lorsqu’une obstruction soudaine empêche l’excrétion de l’humeur aqueuse. L’accumulation de liquide entraîne alors une élévation rapide et marquée de la pression dans l’œil. Elle s’accompagne de symptômes comme de violents maux de tête, des douleurs et rougeurs oculaires, des nausées et vomissements, une vision floue et des halos lumineux. Sans traitement, cette affection peut entraîner une perte de vision soudaine et irréversible. Si vous présentez ces symptômes, consultez immédiatement un médecin. Si la maladie est prise en charge rapidement, votre œil a de bonnes chances de se rétablir sans séquelles permanentes.
Glaucome à tension normale
Le glaucome à tension normale se caractérise par une atteinte du nerf optique malgré l’absence d’élévation importante de la pression intraoculaire. On ne connaît pas encore la cause de cette affection, mais on pense qu’elle pourrait être due à des variations dans la structure anatomique du nerf optique ou à une mauvaise perfusion vasculaire entraînant des lésions.
Glaucome congénital
Le glaucome congénital est une maladie pédiatrique généralement diagnostiquée entre l’âge de 3 et de 6 mois. Les enfants qui en sont atteints souffrent d’un mauvais drainage de l’œil qui entraîne une augmentation de la pression intraoculaire.
Ce type de glaucome est parfois d’origine héréditaire, parfois non. La maladie entraîne rarement une perte de vision irréversible si elle est détectée et prise en charge à temps. Parmi les symptômes possibles, mentionnons une mégalocornée (des yeux anormalement grands), des yeux voilés, des larmoiements, des rougeurs et une forte sensibilité à la lumière.
Glaucome pigmentaire
Dans le glaucome pigmentaire, de petites particules de pigment – c’est-à-dire de la couleur de l’iris – peuvent se détacher et former des dépôts. Chez certaines personnes, ces dépôts finissent par obstruer le conduit d’évacuation de l’œil et provoquer une élévation de la pression intraoculaire. Lorsque cette accumulation endommage le nerf optique, on parle alors de glaucome pigmentaire. Cette forme de glaucome touche surtout les hommes de 20 à 40 ans ainsi que les adultes de cette tranche d’âge atteints de myopie. Il peut arriver que des efforts physiques intenses accentuent la dispersion de granules de pigments dans l’œil. C’est pourquoi il est important de consulter un professionnel de la santé avant d’entreprendre tout programme d’entraînement. La maladie est souvent asymptomatique à ses débuts. En progressant, elle peut causer des difficultés à voir sur les côtés, une vision floue ou l’apparition de halos lumineux.
Glaucome secondaire
On parle de glaucome secondaire lorsque la maladie est causée par une autre affection ou un traumatisme à l’œil. Le glaucome secondaire peut être provoqué, par exemple, par une lésion oculaire, la prise de certains médicaments (comme les stéroïdes), de l’inflammation ou des cataractes avancées liées au diabète. Même si les causes peuvent varier, l’élévation de la pression dans l’œil et les atteintes du nerf optique s’apparentent à celles des autres formes de glaucome. Le traitement varie selon la cause.
FACTEURS DE RISQUE
Le glaucome peut toucher tout le monde, mais il existe plusieurs facteurs de risque qui prédisposent certaines personnes à développer la maladie, dont les suivants :
- Pression intraoculaire élevée
- Hypertension artérielle
- Antécédents familiaux de glaucome
- Épaisseur de la cornée
- Âge supérieur à 55 ans
- Lésions oculaires antérieures
- Prise de stéroïdes sur une longue période
- Origines africaines, asiatiques ou hispaniques
- Myopie
- Diabète
DIAGNOSTIC
Le glaucome peut toucher un œil ou les deux, mais ne provoque généralement aucun symptôme au début. Des examens de la vue réguliers sont donc indispensables pour permettre à votre ophtalmologue de détecter la maladie à temps, avant que votre vision ne soit affectée. Consultez votre spécialiste si vous présentez l’un ou plusieurs des symptômes suivants :
- Perte de vision périphérique (sur les côtés);
- Halos lumineux;
- Douleurs ou rougeurs oculaires;
- Vision trouble ou perte d’acuité visuelle;
- Douleurs oculaires.
Afin de préciser le diagnostic, votre ophtalmologue pourrait procéder à divers examens, dont :
- un test d’acuité visuelle, pour évaluer la vision à distance;
- un examen du champ visuel, pour évaluer la vision périphérique;
- un examen du fond de l’œil, pour vérifier si le nerf optique est atteint;
- un examen tonométrique, pour mesurer la pression intraoculaire;
- un test de pachymétrie cornéenne, pour mesurer l’épaisseur de la cornée.
TRAITEMENTS
Il n’existe actuellement aucun remède contre le glaucome, mais certains traitements peuvent réduire l’accumulation de liquide à l’origine de la détérioration du nerf optique. En posant un diagnostic précoce, votre ophtalmologue pourra déterminer le ou les types de traitement les mieux adaptés en fonction de la gravité de votre état de santé.
Gouttes ophtalmiques
Les gouttes ophtalmiques constituent le traitement de première intention le plus couramment prescrit. Pour qu’elles soient efficaces, il est très important de les appliquer régulièrement. Selon votre état de santé, vous pourriez devoir utiliser une combinaison de différentes gouttes ophtalmiques. Suivez bien les consignes du pharmacien, notamment en respectant un délai d’au moins cinq minutes entre chaque type de gouttes. Les catégories de gouttes ophtalmiques les plus souvent prescrites sont les suivantes [2] :
- Prostaglandine : ces gouttes réduisent la pression oculaire en facilitant l’évacuation de l’humeur aqueuse. Elles comportent toutefois des effets secondaires, dont une légère irritation oculaire, un changement de la couleur des yeux et un allongement des cils.
- Béta-bloquants : ces gouttes diminuent la sécrétion de liquide à l’intérieur de l’œil, mais peuvent causer un ralentissement du rythme cardiaque, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et de la fatigue.
- Agonistes alpha-adrénergiques : ces gouttes limitent la quantité de liquide qui circule dans l’œil tout en en améliorant l’écoulement. Elles peuvent cependant entraîner de l’arythmie cardiaque, de l’hypertension artérielle, des rougeurs et de l’irritation oculaires, une sécheresse buccale et de la fatigue. En général, ces médicaments sont à prendre à raison de deux ou trois fois par jour.
- Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique : ces gouttes réduisent la quantité de liquide sécrété par l’œil. Elles peuvent entraîner des effets secondaires comme un goût métallique dans la bouche, des mictions fréquentes et des fourmillements dans les doigts et les orteils. Ces médicaments sont à prendre à raison de deux ou trois fois par jour.
- Inhibiteurs de la rho kinase : ces gouttes réduisent la sécrétion de liquide dans l’œil, mais peuvent provoquer des rougeurs oculaires et de l’inconfort.
- Myotiques et agents cholinergiques : ces gouttes favorisent l’écoulement de l’humeur aqueuse, mais sont de moins en moins prescrites, car elles causent des maux de tête, des douleurs oculaires et des altérations de la vision. De plus, elles doivent être administrées fréquemment, soit jusqu’à quatre fois par jour.
Médicaments oraux
Si les gouttes ophtalmiques ne suffisent pas à réguler la pression intraoculaire, votre médecin pourrait vous prescrire un inhibiteur de l’anhydrase carbonique ou un autre type de médicament par voie orale.
Chirurgie au laser
La chirurgie au laser peut s’avérer un traitement intéressant pour certaines personnes atteintes de glaucome. Le traitement au laser le plus répandu est appelé « trabéculoplastie ». Cette intervention consiste à administrer des gouttes anesthésiantes, puis à appliquer un faisceau laser sur l’œil à l’aide d’une lentille spécialisée. Le laser agit en élargissant l’ouverture des voies d’évacuation de l’humeur aqueuse. Cette procédure, généralement indolore, peut être effectuée dans le cabinet du médecin et vous permet normalement de reprendre vos activités dès le lendemain. Le laser donne de bons résultats chez la plupart des gens, mais il faut patienter 4 à 6 semaines pour en voir les effets. Même après une chirurgie au laser, il est possible que vous deviez continuer à appliquer des gouttes ophtalmiques. Il est primordial de consulter régulièrement votre ophtalmologue pour surveiller votre pression oculaire. En effet, les résultats de la chirurgie au laser peuvent être temporaires et la procédure pourrait devoir être répétée.
Chirurgie classique
Outre la trabéculoplastie, des techniques chirurgicales plus conventionnelles peuvent être envisagées pour le traitement du glaucome. Généralement regroupées sous le vocable de « trabéculectomie », ces procédures sont réalisées en salle d’opération. Une petite incision est pratiquée dans la partie blanche de l’œil appelée « sclère » pour faciliter l’excrétion de l’humeur aqueuse et ainsi réduire la pression intraoculaire. Ces techniques peuvent cependant entraîner des effets indésirables et ne sont généralement employées qu’en dernier recours.
Chirurgie mini-invasive du glaucome (CMIG)
La CMIG désigne un ensemble de dispositifs et d’interventions mis au point pour abaisser la pression intraoculaire en augmentant la quantité d’humeur aqueuse excrétée ou en réduisant la quantité d’humeur aqueuse sécrétée. La CMIG fait l’objet d’un recours croissant au Canada. Plusieurs techniques de CMIG s’avèrent prometteuses pour le traitement de certains types de glaucome, notamment dans les cas où la chirurgie classique est contre-indiquée. Comme elles sont moins invasives, ces procédures favorisent une convalescence plus courte qu’avec les chirurgies conventionnelles. Des études montrent toutefois que la CMIG n’est pas forcément plus efficace que les autres traitements. Consultez votre médecin pour savoir quel traitement est le mieux adapté à votre situation.
Recherche
Plusieurs groupes de recherche mettent au point des traitements contre le glaucome – qu’il s’agisse de pharmacothérapie, de régénération du nerf optique ou du ciblage de certains gènes.
- Pharmacothérapie : plusieurs types de médicaments sont actuellement à l’étude pour traiter le glaucome. On s’intéresse notamment au rôle protecteur de certaines vitamines, à des médicaments capables d’abaisser davantage la pression intraoculaire et à des gouttes ophtalmiques à libération lente réduisant la fréquence d’administration.
- Régénération du nerf optique : plusieurs équipes de recherche examinent la manière dont les thérapies cellulaires, telles que les traitements par cellules souches, peuvent être mises à profit pour traiter la perte de vision occasionnée par le glaucome. Des recherches en cours laissent entrevoir qu’à terme, les cellules souches pourraient être utilisées pour protéger le nerf optique ou rétablir la vision réduite par le glaucome. Pour l’instant, ces pistes en sont encore au stade expérimental et ne sont pas prêtes à être testées chez l’humain.
- Ciblage de gènes : les scientifiques examinent aussi des façons de remplacer les gènes défectueux à l’origine des formes génétiques de glaucome. Pour l’heure, ces recherches sont menées sur des animaux et ne sont pas encore testées chez l’humain.
- Découvrez trois projets de recherche sur le glaucome financés par Vaincre la cécité Canada (en anglais).
RESSOURCES
Vaincre la cécité Canada a élaboré des ressources pour vous aider à trouver vos repères dans le domaine de la santé oculaire. Consultez les liens ci-dessous pour en savoir plus.
- Abonnez-vous à notre infolettre pour rester au fait des plus récentes avancées de la recherche et des activités de notre communauté.
- Notre ligne d’information santé (en anglais) est à votre disposition. N’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler pour toute question concernant la santé de vos yeux.
- Découvrez les plus récentes percées de la science et allez à la rencontre d’autres personnes grâce à notre série éducative View Point (en anglais).
- Consultez cette liste de lecture YouTube (en anglais) pour accéder à nos précédents webinaires sur le glaucome.
- Feuillet d’information sur le glaucome : ENGLISH | FRANÇAIS
- Parcourez les études financées par Vaincre la cécité Canada.
- La vidéo suivante (en anglais) présente une brève synthèse du glaucome :
Références
[1] https://glaucoma.org/learn-about-glaucoma/types-of-glaucoma/
[2] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/diagnosis-treatment/drc-20372846
Document mis à jour le 21 mars 2024
Unissons nos forces
Découvrez comment votre soutien peut contribuer à tracer un avenir sans cécité! Soyez informé en exclusivité des dernières percées de la recherche en santé de la vision et des événements dans votre région en vous abonnant à notre infolettre.